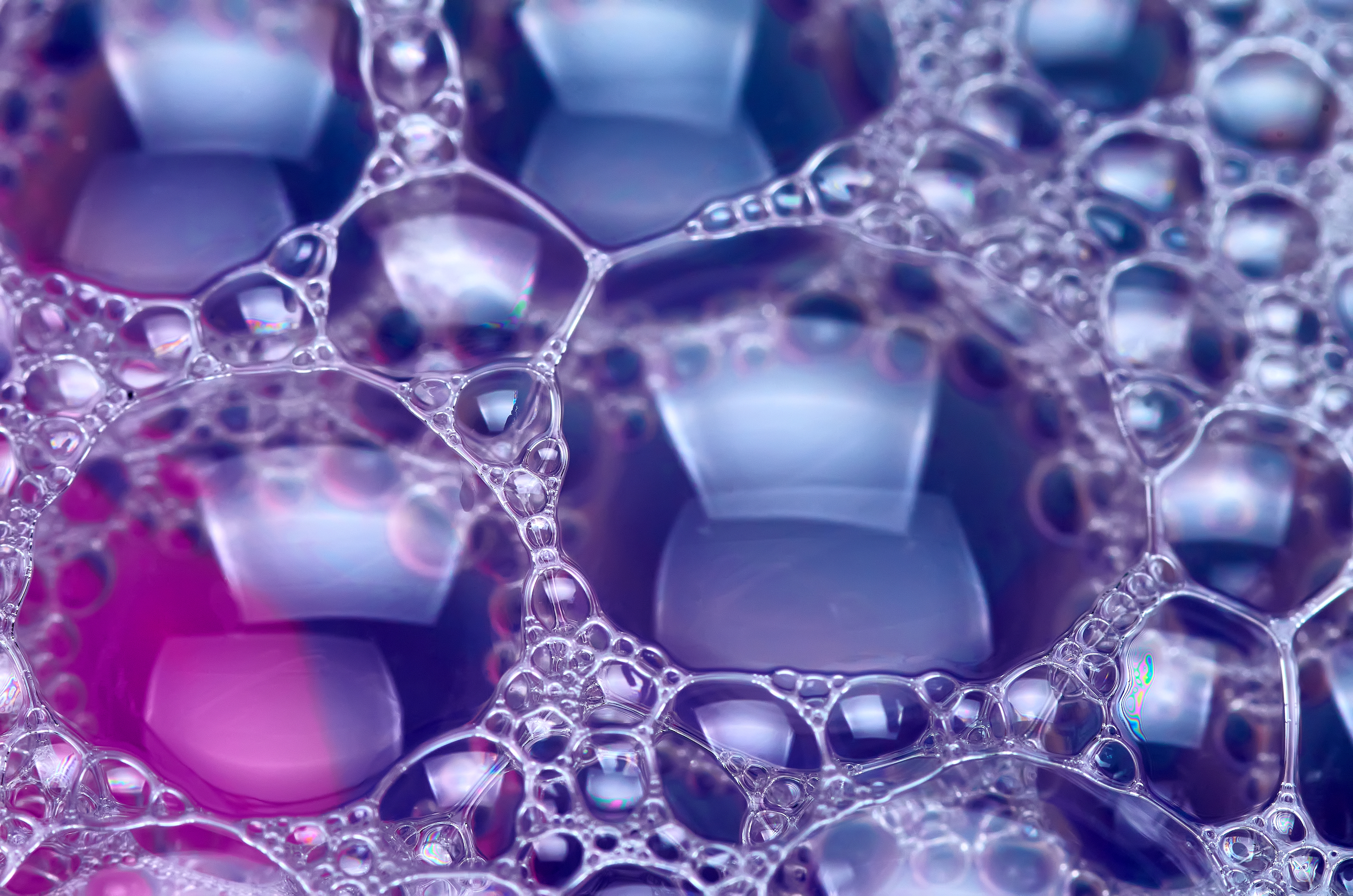Les bactéries miroirs : des organismes intrigants aux conséquences potentiellement désastreuses
Les bactéries miroirs sont des formes de vie hypothétiques qui suscitent un grand intérêt en biologie de synthèse. Elles tirent leur nom de leur composition en molécules synthétiques, qui seraient le reflet de celles trouvées dans la nature. En effet, la configuration de ces substances, c’est-à-dire la disposition de leurs atomes dans l’espace, serait inversée par rapport à celle des molécules naturelles, comme nos deux mains dans un miroir. Ce phénomène est appelé « chiralité inversée ». Les molécules miroirs pourraient offrir de nombreux avantages dans le domaine de la santé et de l’industrie. Cependant, dans un article publié en décembre 2024 dans la revue Science, trente-huit scientifiques ont mis en garde contre les bactéries miroirs, les considérant comme une menace potentielle pour la vie sur Terre. Alors, faut-il réellement craindre ces organismes ?
La distinction entre recherche sur les molécules miroirs et création de bactéries miroirs
Selon Hervé Chneiweiss, neurobiologiste et président du comité d’éthique de l’Inserm, il est primordial de distinguer deux aspects de l’étude des bactéries miroirs : la recherche sur les molécules miroirs et la création de bactéries miroirs. La première offre des perspectives prometteuses en termes d’avancées fondamentales et appliquées. Elle pourrait notamment aider à résoudre l’énigme de l’utilisation exclusive de l’ADN « droitier » et des acides aminés « gauchers » dans la vie sur Terre. Sur le plan appliqué, les molécules miroirs pourraient conduire à la création de médicaments plus efficaces, grâce à leur capacité à échapper à la reconnaissance des enzymes humaines. Elles pourraient également présenter des propriétés intéressantes pour l’industrie, telles qu’une meilleure conductivité électrique ou résistance mécanique. Cependant, si ces recherches devaient aboutir à la création de bactéries miroirs, les conséquences pourraient être catastrophiques. En effet, ces organismes seraient invisibles pour notre système immunitaire et pourraient détruire la vie sur Terre. Aucun antibiotique actuel ne serait capable de les combattre. C’est pourquoi les auteurs de l’article de 2024 ont appelé à un moratoire sur la recherche concernant les bactéries miroirs, afin d’évaluer les risques et de prendre des mesures préventives. Hervé Chneiweiss soutient pleinement cette initiative.
Le risque réel, mais pas immédiat
Selon Ariel Lindner, directeur de l’unité Évolution et ingénierie de systèmes dynamiques (Inserm/Sorbonne Université) et spécialiste en biologie de synthèse, le risque lié aux bactéries miroirs est réel mais ne devrait pas se concrétiser de sitôt. À l’heure actuelle, aucun scientifique n’a réussi à créer de telles bactéries. Certes, en 2022, des chercheurs chinois ont réussi à produire des ARN miroirs en synthétisant une enzyme miroir, appelée « ARN polymérase ». Cependant, la création de bactéries miroirs complètes nécessiterait encore de nombreuses années de recherche. En effet, il faudrait être en mesure de produire des ribosomes miroirs, essentiels à la synthèse des protéines, ainsi que d’autres éléments clés. De plus, la création de ces bactéries n’apporterait aucun avantage significatif, tant sur le plan de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. D’autres recherches présentent des risques sanitaires plus immédiats, comme celles portant sur des organismes ayant un potentiel d’utilisation en tant qu’armes biologiques. Cependant, réfléchir à une réglementation appropriée pour encadrer la recherche sur les bactéries miroirs et prévenir les éventuels dangers est essentiel. Cette démarche permettra de garantir une recherche responsable en biologie de synthèse, bénéfique pour l’humanité sans mettre en péril la vie sur Terre.
Pourquoi les sucres pourraient changer la donne ?
Selon Anne Imberty, glycobiologiste au Centre de recherches sur les macromolécules végétales (CNRS/Université Grenoble Alpes), il n’est pas certain que les bactéries miroirs puissent réellement passer inaperçues face à notre système immunitaire. C’est l’idée que nous avons développée, avec plusieurs spécialistes en glycobiologie, dans une réponse publiée en février 2025 à l’article de Science. La glycobiologie, rappelons-le, est la discipline qui étudie les glucides – aussi appelés glycanes ou « sucres ».
L’argument selon lequel les bactéries miroirs pourraient représenter une menace pour la vie terrestre repose principalement sur les risques liés aux acides nucléiques (ADN et ARN) et aux protéines miroirs, en négligeant largement l’importance des glucides. Or, toutes les bactéries possèdent à leur surface une couche dense de sucres complexes, capables d’être reconnus par notre immunité et de déclencher une réponse défensive.
Un point essentiel est que, contrairement aux protéines et aux acides nucléiques, de nombreux sucres existent naturellement sous leurs deux formes, gauche et droite. À titre d’exemple, le mannose des eucaryotes – organismes à cellules nucléées, comme les nôtres – est de forme droite, tandis que beaucoup de bactéries exploitent des dérivés du mannose sous configuration gauche. Ainsi, même si les systèmes immunitaires des vertébrés ne détectent pas les protéines ou acides nucléiques miroirs, ils sont en revanche familiers des sucres miroirs, avec lesquels ils ont co-évolué depuis des millions d’années.
Par conséquent, une partie des sucres présents à la surface des bactéries miroirs – et donc ces bactéries elles-mêmes – pourrait être reconnue par nos défenses immunitaires. Cela reste toutefois à démontrer expérimentalement. En attendant, un moratoire sur la recherche concernant les bactéries miroirs demeure justifié.
Sources :
Cet article a été adapté à partir de contenus publiés par l’Inserm. Retrouvez l’article source et l’ensemble des références sur le site de l’Inserm.