Soutenir la santé des femmes
Un impératif de recherche et d’égalité

Pourquoi la santé des femmes est-elle un enjeu majeur de santé publique ?
La santé des femmes répond à des besoins spécifiques, profondément enracinés dans les différences biologiques, hormonales et sociales. Les femmes ne doivent plus être considérées en quelque sorte comme des corps humains par défaut. 1 Ces spécificités influencent le déclenchement des maladies, leur diagnostic, leur prise en charge médicale ainsi que leur vécu subjectif.
Malgré cette réalité, les femmes demeurent encore trop souvent les grandes oubliées de la recherche. Longtemps exclues des essais cliniques, elles continuent d’être sous-diagnostiquées dans des pathologies pourtant graves, comme l’infarctus, dont les symptômes féminins atypiques sont méconnus. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement 10 % des budgets de recherche en santé sont spécifiquement consacrés aux femmes.2
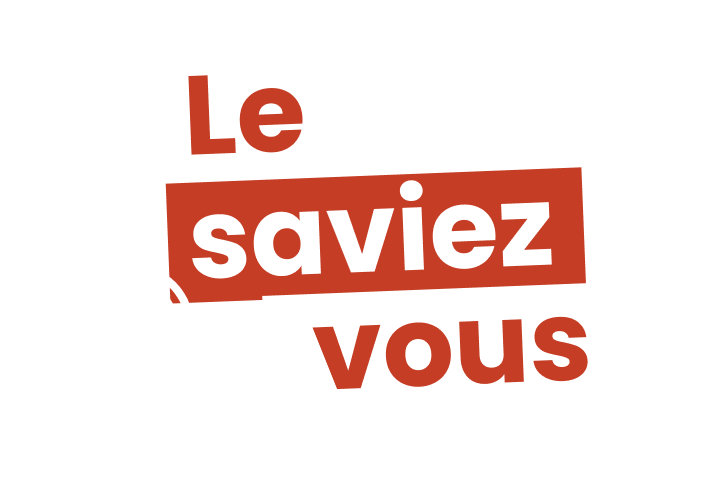
Les femmes sont sous-représentées dans les études de santé et les essais cliniques, et leur douleur est souvent banalisée.
Pour être pleinement efficace, la recherche biomédicale et l’organisation des soins doivent prendre en compte les spécificités biologiques et physiopathologiques propres aux femmes, afin de garantir à toutes et à tous une qualité de prise en charge équivalente. Prendre en compte la santé des femmes, c’est réparer des décennies d’injustices scientifiques, médicales et sociales.
1 Muriel Salle – Historienne, experte en études genre et santé (UE « Corps, genre, santé »)
Contributrice du rapport du Haut Conseil à l’Égalité sur la prise en compte du sexe/genre en santé (2020
2 Une étude publiée dans la revue Nature en 2020 a révélé que seulement 10% des budgets de recherche des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis étaient alloués à des études portant spécifiquement sur les femmes. Ce chiffre, bien que limité aux États-Unis, illustre le problème plus large du manque de financement pour la recherche sur la santé des femmes.
Les grandes pathologies féminines : panorama de la recherche menée à l’Inserm
Santé gynécologique : endométriose et fibromes utérins
L’endométriose touche environ une femme sur dix, provoquant des douleurs sévères et invalidantes. Pourtant, le diagnostic est souvent posé après un parcours de 7 ans en moyenne. L’Inserm investit dans l’identification de biomarqueurs, l’étude des mécanismes inflammatoires et hormonaux, et le développement de traitements innovants.
Autre pathologie largement ignorée : les fibromes utérins, qui concernent huit femmes sur dix. Bien que fréquents, ils restent peu étudiés malgré leur impact sur la qualité de vie. La Fondation Inserm promeut aujourd’hui un programme de recherche ambitieux pour faire émerger une nouvelle équipe dédiée.
Témoignage
« La santé des femmes est aujourd’hui mieux prise en compte, en particulier sur les sujets de la fertilité, l’ostéoporose, l’endométriose, la contraception et la ménopause. Mais il reste encore de nombreux champs non explorés et des besoins de combler des écarts de soin, sur les maladies cardiovasculaires par exemple ou le traitement de la douleur. Il convient donc d’engager de nouveaux travaux de recherche, que la Fondation Inserm pourra accompagner. »
Marina Kvaskoff – épidémiologiste et chercheuse Inserm dans l’équipe « Exposome, Hérédité, Cancer et Santé » du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif.
Marina Kvaskoff se consacre à l’étude de l’endométriose, une maladie qui touche 10 % des femmes en France. Actuellement, il faut entre 6 à 10 ans pour qu’un diagnostic soit posé, une fois les symptômes apparus, ce qui retarde considérablement la prise en charge. Les recherches de Marina Kvaskoff portent également sur le fibrome, une pathologie qui concerne 25 % des femmes en France, et sur laquelle nous avons peu de connaissances.
Maladies cardiovasculaires : première cause de mortalité chez les femmes
Chaque année, 75 000 femmes décèdent de maladies cardiovasculaires en France, soit davantage que de cancers. Les symptômes féminins, souvent différents de ceux des hommes, sont insuffisamment reconnus par les professionnels de santé.
30%
des femmes sont plus susceptibles que les hommes de se présenter avec les symptômes d’un AVC, puis d’être mal diagnostiquées avant d’être renvoyées chez elles.
L’Inserm mène notamment des recherches sur la dissection coronaire spontanée (SCAD), une forme d’infarctus qui touche des femmes jeunes sans facteurs de risque connus.
Cancers
Selon les chiffres de Santé publique (données 2023), ce sont les cancers du sein qui sont le plus fréquents chez les femmes (33% des cas), suivis par le cancer colorectal (11% des cas) et le cancer du poumon (10% des cas). Les cancers gynécologiques comme le cancer du col de l’utérus, de l’ovaire, et de l’utérus sont également des préoccupations majeures en santé féminine.
Les chercheurs étudient l’influence de facteurs hormonaux (comme l’âge de la puberté, la ménopause, ou la prise d’hormones), de facteurs liés au mode de vie (comme l’alimentation, l’activité physique, ou la consommation d’alcool), de facteurs génétiques (comme les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2), ou encore de facteurs environnementaux (comme l’exposition à certains produits chimiques). Prévention : Les études portent sur l’évaluation de l’efficacité de différentes stratégies de prévention, comme la mammographie de dépistage, la chimioprévention (prise de médicaments pour réduire le risque), ou la chirurgie prophylactique (ablation préventive des seins ou des ovaires chez les femmes à très haut risque).
Pour le Cancer du col de l’utérus : Facteurs de risque : le principal facteur de risque est l’infection par le virus du papillomavirus humain (HPV). Les chercheurs cherchent à mieux comprendre les mécanismes par lesquels le HPV provoque le cancer, et à identifier les autres facteurs qui peuvent augmenter le risque (comme le tabagisme, ou un système immunitaire affaibli) Prévention : les recherches se concentrent sur l’amélioration du dépistage (frottis cervico-utérin, test HPV), sur le développement de vaccins contre le HPV plus efficaces, et sur la mise en place de programmes de vaccination pour les jeunes filles et les jeunes garçons.
Autres cancers féminins : comme le cancer de l’ovaire ou le cancer de l’endomètre. Les chercheurs étudient les facteurs de risque spécifiques à ces cancers, et cherchent à développer de nouvelles méthodes de dépistage et de prévention.
Impact : Amélioration du dépistage et de la prise en charge des cancers féminins.
Troubles hormonaux et métaboliques
Les troubles hormonaux et métaboliques désignent des dérèglements du système endocrinien (qui produit les hormones) ou du métabolisme (l’ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans l’organisme). Chez les femmes, ces troubles sont particulièrement pertinents car les hormones féminines influencent de nombreux processus corporels et leur déséquilibre peut avoir des conséquences étendues.
Ils peuvent se manifester par :
- Des déséquilibres hormonaux comme l’excès d’hormones mâles (hyperandrogénie) dans le Syndrome des Ovaires Polykystiques (SOPK), ou la carence en œstrogènes lors de la ménopause.
- Des complications métaboliques telles que la résistance à l’insuline, qui peut conduire au diabète de type 2, à l’obésité, et à un risque accru de maladies cardiovasculaires.
Ces troubles peuvent affecter le cycle menstruel, la fertilité, la prise de poids, la santé cardiovasculaire, osseuse et même la cognition.
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui affecte 5 à 10 % des femmes en âge de procréer, est une cause majeure d’infertilité et un facteur de risque métabolique. À la ménopause, les changements hormonaux ont des effets sur les os, le cœur ou encore la cognition. L’Inserm explore ces mécanismes, notamment les effets du sevrage œstrogénique, pour anticiper des stratégies de prévention ciblées.
La ménopause
Si la ménopause n’est pas une maladie, la carence en œstrogènes qui lui est associée peut se manifester par des symptômes qui affectent parfois la qualité de vie des femmes. C’est aussi une période où des pathologies potentiellement graves (fractures ostéoporotiques, maladies cardiovasculaires…) peuvent survenir en raison de ces changements hormonaux et du vieillissement.
On estime à 20 à 25% des femmes qui sont affectées par des troubles sévères.
La diminution du taux d’œstrogènes circulant dans l’organisme va de pair avec la diminution des bénéfices physiologiques qu’apportent ces hormones sur le plan cardiovasculaire, osseux ou cognitif.
Dans les premières années suivant l’arrêt des règles, les femmes ménopausées voient ainsi leur risque de maladies cardiovasculaires augmenter au niveau de celui des hommes. Elles sont par ailleurs souvent exposées à une perte osseuse qui entraîne une baisse de leur densité minérale osseuse (DMO), favorisant la survenue de l’ostéoporose. Cette pathologie est deux à trois fois plus fréquente chez les femmes ménopausées que chez les hommes du même âge.
Santé mentale et variations hormonales
Les femmes sont deux fois plus touchées par la dépression et l’anxiété, souvent en lien avec les grandes étapes hormonales : puberté, grossesse, postpartum, ménopause. Les équipes de recherche s’intéressent aux interactions entre hormones et neurotransmetteurs, avec l’ambition de proposer des traitements mieux personnalisés.
Maladies Auto-Immunes
Les femmes sont majoritairement touchées par la plupart des maladies auto-immunes (ex: lupus, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, thyroïdite de Hashimoto).
La Fondation Inserm abrite l’Institut hospitalo-universitaire Immun4Cure de Montpellier labellisé par l’Etat dans le cadre de France 2030.
Expositions environnementales
Les perturbateurs endocriniens, les pesticides et la pollution environnementale ont un impact bien documenté sur la fertilité, les cancers hormonodépendants et de nombreuses pathologies chroniques. L’Inserm mène plusieurs projets pour mieux comprendre ces liens et proposer des politiques de prévention adaptées à la santé féminine.
Inégalités sociales et systémiques : des freins multiples à la santé des femmes
Les barrières d’accès aux soins ne sont pas uniquement biologiques. Les femmes, en particulier celles issues de milieux précaires, les mères célibataires ou encore les femmes racisées, font face à des retards de diagnostic, une méconnaissance de leurs symptômes spécifiques et des obstacles structurels dans le système de santé.
Au travail, la santé féminine est encore un tabou. La charge mentale, le burn-out et les discriminations restent fréquents.
Chiffres clés* :
- – 1 femme sur 3 se sent en mauvaise santé mentale ou physique.
- – 20 % des femmes actives sont en situation de burn-out ou proche
- – Près de 3 femmes sur 10 sont gênées par certains aspects de leur santé féminine, c’est deux fois plus lorsqu’elles souffrent de pathologies féminines
- – 20 jours d’arrêt maladie/an en moyenne chez les femmes souffrant de pathologies féminines.
- – 1 femme sur 4 estime que ses douleurs menstruelles pénalisent sa carrière
- – 73 % disent craindre d’être jugées si elles parlent de leur santé au travail
*(source BVA/VYV 2024)
Selon une enquête de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), près de trois quarts des femmes cadres ayant eu des enfants estiment que le congé maternité ralentit leur progression hiérarchique pendant plusieurs années. De plus, 47 % des mères interrogées jugent que la reprise au travail a été difficile, voire très difficile pour 14 % d’entre elles. D’après les données du Baromètre santé 2021 de Santé publique France, 12,5 % des personnes âgées de 18 à 85 ans auraient vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois. La prévalence est plus élevée chez les femmes, atteignant 15,6 %, contre 9,3 % chez les hommes.
Vers une égalité en santé les engagements de la Fondation Inserm
Face à ces constats, la Fondation Inserm s’engage à promouvoir une recherche exigeante, inclusive et utile pour toutes. Elle porte des projets pionniers sur des thématiques encore marginalisées comme :
- le SCAD et les infarctus chez les femmes jeunes ;
- les troubles hormonaux tels que le SOPK ;
- les conséquences des violences sexistes sur la santé physique et psychique.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour changer cela.
En soutenant la Fondation Inserm, vous contribuez à faire avancer les connaissances sur des pathologies trop longtemps négligées : endométriose, maladies cardiovasculaires féminines, troubles hormonaux, impact des violences ou des expositions environnementales sur la santé des femmes… Leur impact est, en effet, majeur sur la qualité de vie des femmes et sur l’économie des entreprises, en raison des absences et difficultés qu’elles peuvent occasionner.
Votre don permet de financer des programmes de recherche innovants, d’accompagner des équipes engagées, et de porter une médecine plus équitable, fondée sur l’excellence scientifique.
Agissez concrètementpour une santé plus juste :
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour changer cela.
Chaque geste compte.
Chaque euro investi, c’est une avancée pour des milliers de femmes.
Nous comptons sur vous.
